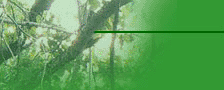|
LE TOUR EIFFEL
|
La Tour Eiffel, symbole d'audace technique de la fin du XIXe siècle, a conservé
son attrait universel. |
|
Si maintenant 6 millions de visiteurs l'escaladent annuellement, ce chiffre est faible comparé au
nombre de ceux qui l'on vue sans jamais y monter et de ceux qui la connaissent sans jamais l'avoir vue. Sa représentation
schématique en fait un objet figé, une référence immuable. Or, contrairement à beaucoup d'édifices symboles du passé, elle
vit, elle change et elle évolue.
Les plus spectaculaires de ses transformations sont aussi les plus superficielles
: la couleur de sa peinture qui a changé 6 fois au cours de son histoire et les effets lumineux dont elle a été parée soit
pour un jour, soit pour plus longtemps. Ainsi après différentes manières de l'illuminer, la dernière met en valeur sa structure
interne depuis maintenant plus de 10 années.
Moins spectaculaires mais apparents sont les aménagements des plates-formes et les décors rapportés
à l'édifice : les pavillons et constructions diverses du 1er et du 2e étages, les couvertures des galeries
et abris contre les intempéries : embarcadères, débarcadères, promenoirs, etc., sans compter de nombreux locaux techniques
et de service parsemant les étages ou les espaces au dessus ou au dessous de ceux-ci. |
|
|
|
Peuvent figurer aussi dans cette catégorie les moyens d'ascension et la construction
ou le remplacement d'escalier d'ascenseurs : et de plates-formes dans la mesure où ces derniers n'interviennent pas dans l'équilibre
de l'édifice.
Beaucoup moins visibles sont les modifications qui ont été opérées sur la structure primaire de l'édifice.
En effet,
à différentes périodes, l'ossature même a évolué, soit au fur et à mesure de nouveaux besoins, soit pour renforcer des structures
ayant souffert de dommages divers. |
|
Gustave EIFFEL dans son ouvrage descriptif "LA TOUR DE 300 METRES" donne des indications
précises sur le résultat de ses calculs, sur les quantités employées et sur les détails de ses observations. |
|
|
|
Tous les documents datant de 1889 et 1900 en sont extraits ainsi que les données chiffrées.
En fait, pour atteindre ses quelques 300 mètres, la Tour est composée essentiellement de 2 éléments
:
- une base, sorte de tabouret à un barreau, solide, reposant sur 4 piles liaisonnées et prolongées jusqu'à la plate-forme
réduite que constitue le 2e étage,
- un pylône ancré fortement dessus. |
|
La valeur de l'empattement est directement liée aux forces de renversement dues au vent.
Le diagramme
des poids de la Figure 2 montre le rapport de l'utilisation de la matière aux différents niveaux en fonction du calcul schématisé
dans les Figures 3 et 4. On y remarque la dégressivité de l'effet des forces dues au vent et le rapport obtenu à la base.
( Lire : Principe de la construction selon Gustave Eiffel ) |
|
C'est ce qui a donné la forme théorique de la Tour mais il restait à la construire.
La plus grand
difficulté de son édification en a été la jonction des quatre piles à la hauteur du 1er étage.
En effet, avec
les moyens de l'époque, la tâche consistait à implanter, avec le plus de précision possible 4 massifs espacés de 80 mètres
les uns les autres, à élever 4 piles biaises et à caler celles-ci à une altitude précise au millimètre près à une cinquantaine
de mètres au dessus du sol. |
|
|
|
|
|
L'édification des piles, autostables, au dessus du 1er étage a posé moins de problèmes.
Quant
au pylône, il a été réalisé avec moins de difficultés, hormis celles liées aux travaux de grande hauteur.
Le principe
de cette structure fait apparaître 2 parties où elle est plus sollicitée :
- la liaison horizontale du 1er étage
(poutres de 7 mètres).
- la base du pylône.
Ces deux points sont développés plus loin.
Le matériau employé pour
la structure est le fer puddlé et non l'acier.
La Tour a été assemblée au moyen d'un nombre restreint de sortes de pièces
usinées, témoin en est la liste extraite du livre de Monsieur EIFFEL. |
|
A cette
liste doivent être ajoutées quelques pièces de fonte moulées dont les principales sont les 16 appuis des arbalétriers, en
liaison entre la maçonnerie et la structure. |
|
Les pièces utilisées pour la construction de la Tour
Il a été dit que tous les fers provenaient des usines de MM.
Dupont et Fould, maîtres de forges à Pompey (Meurthe-et-Moselle) représentés par M. A. Prègre, leur directeur à Paris, et
nous avons indiqué la qualité des fers. Ils ont été livrés aux prix suivants:
|
Cornières
égales de 40 à 100 |
.................................. |
13.25 |
frs les
100 kg |
|
Fers marchands de 1re et 2e classes |
.................................. |
13.25 |
frs les
100 kg |
|
Fers marchands de 3e et 4e classes |
.................................. |
13.75 |
frs les
100 kg |
|
Larges plats
jusqu'à 500 |
.................................. |
15.00 |
frs les
100 kg |
|
Tôles ordinaires |
.................................. |
15.50 |
frs les
100 kg |
|
Tôles striées |
.................................. |
16.50 |
frs les
100 kg |
|
Fers spéciaux simple T de l'album |
.................................. |
16.00 |
frs les
100 kg |
|
Cornières ouvertes et fermées aux angles demandés |
.................................. |
20.00 |
frs les 100 kg |
Les rivets ont été fournis par MM. Letroyeur et Bouvard à Paris. La
qualité était celle des rivets des chaudières de locomotives. |
|
Le montage des piles commence le 1er juillet 1887 pour s'achever vingt-et-un mois plus tard.
|
|
Tous les éléments sont préparés à l'usine de Levallois-Perret à côté de Paris, siège de l'entreprise
Eiffel. Chacune des 18 000 pièces de la Tour est dessinée et calculée avant d'être tracée au dixième de millimètre et assemblée
par éléments de cinq mètres environ. Sur le site, entre 150 et 300 ouvriers, encadrés par une équipe de vétérans des grands
viaducs métalliques, s'occupent du montage de ce gigantesque meccano. |
|
Ateliers de Levallois-Perret
|
|
Toutes les pièces métalliques de la Tour sont fixées par des rivets, un mode de construction
bien rôdé à l'époque de la construction de la Tour. |
|
Equipe de riveurs
|
|
Les assemblages sont d'abord réalisés sur place par des boulons provisoires, remplacés au fur et à
mesure par des rivets posés à chaud. En se refroidissant, ils se contractent, ce qui assure le serrage des pièces les unes
avec les autres. Il faut une équipe de quatre hommes pour poser un rivet : un pour le chauffer, un pour le tenir en place,
un pour former la tête, un dernier pour achever l'écrasement à coups de masse. Un tiers seulement des 2 500 000 rivets que
comprend la Tour ont été directement posés sur le site. |
|
Les piles reposent sur des fondations en béton installées à quelques mètres sous le niveau
du sol sur une couche de gravier compact. |
|
Fondations
de la Tour Eiffel
|
|
Construction d'une des piles
|
|
Chaque arête métallique dispose de son propre massif, lié aux autres par des murs, sur lequel
elle exerce une pression de 3 à 4 kilos par centimètre carré. Côté Seine, on a employé des caissons métalliques étanches,
où l'injection d'air comprimé permettait aux ouvriers de travailler sous le niveau de l'eau . |
|
La Tour est montée à l'aide d'échafaudages en bois et de petites grues à vapeur fixées sur
la Tour elle-même. |
|
Le montage du premier étage est réalisé à l'aide de douze échafaudages provisoires en bois de 30 mètres
de hauteur, puis de quatre grands échafaudages de 45 mètres.
Des "boîtes à sable" et des vérins hydrauliques - remplacés après usage par des cales fixes - permettent
de régler la position de la charpente métallique au millimètre près.
La jonction des grandes poutres du premier est ainsi réalisée le 7 décembre 1887. Les pièces sont
hissées par des grues à vapeur qui grimpent en même temps que la Tour, en utilisant les glissières prévues pour les ascenseurs.
|
|
La Tour Eiffel:
un mécano géant
|
|
Il n'a fallu que cinq mois pour construire les fondations et vingt et un mois pour réaliser
le montage de la partie métallique de la Tour. |
|
15 mars 1888
|
|
15 septembre 1888
|
|
26 décembre1888
|
|
12 mars 1889
|
|
|
|
C'est une vitesse record si l'on songe aux moyens rudimentaires de l'époque. Le montage de
la Tour est une merveille de précision, comme s'accordent à le reconnaître tous les chroniqueurs de l'époque. Commencé en
janvier 1887, le chantier s'achève le 31 mars 1889. Gustave Eiffel est décoré de la Légion d'Honneur sur l'étroite plate-forme
du sommet. |
|
Le journaliste Émile Goudeau visitant le chantier au début de 1889 en décrit ainsi le spectacle. |
|
Les ouvriers
de la Tour Eiffel
|
|
"Une épaisse fumée de goudron et de houille prenait à la gorge, tandis qu'un bruit de ferraille rugissant
sous le marteau nous assourdissait. On boulonnait encore par là; des ouvriers, perchés sur une assise de quelques centimètres,
frappaient à tour de rôle de leur massue en fer sur les boulons (en réalité les rivets); on eût dit des forgerons tranquillement
occupés à rythmer des mesures sur une enclume, dans quelque forge de village; seulement ceux-ci ne tapaient point de haut
en bas, verticalement, mais horizontalement, et comme à chaque coup des étincelles partaient en gerbes, ces hommes noirs,
grandis par la perspective du plein ciel, avaient l'air de faucher des éclairs dans les nuées." |
|
Beaucoup de problèmes techniques sont survenus au moment de l’installation des ascenseurs.
Jamais n’avaient été abordé les contraintes de telles hauteurs et de telles charges, rendues encore plus complexes par
des axes en pente et des angles divers. |
|
Dans les piliers Est et Ouest, des ascenseurs qui desservaient le 1er étage furent installés par l'entreprise
française Roux, Combaluzier et Lepape. Peu efficaces, ils furent remplacés en 1899 par des ascenseurs hydrauliques construits
par Fives-Lille. Ces ascenseurs ont fidèlement transporté les touristes jusqu'au deuxième étage jusqu'à la fin des années
1980, date de leurs mises aux normes actuelles.
En 1889, l'entreprise américaine Otis a fourni les ascenseurs des piliers
Nord et Sud qui desservaient le deuxième étage, comprenant une cabine à deux étages tirée par un câble actionné par un piston
hydraulique. Bien inférieurs à ceux fournis par Fives-Lille, ils furent aussi remplacés : celui du pilier Sud en 1900 et celui
du Nord peu après 1912 quand son moteur est définitivement tombé en panne.
Les années 1950 ont vu s'accroître fortement
le nombre de visiteurs. Pour répondre à ces nouveaux besoins une machine à plus grande capacité était devenue nécessaire.
En 1965, Schneider Creusot Loire installe au pilier nord, un nouvel ascenseur basé sur la meilleure machinerie et ingénierie
électronique du moment. De nouvelles cabines et un contrôle assisté par ordinateur sont ajoutés en 1995.
L'ascenseur
du pilier Sud est remplacé en 1983 par un ascenseur électrique d’Otis de petite dimension réservé aux clients du restaurant
"Jules Verne". En 1989, un ascenseur de quatre tonnes réservé au service est installé par Otis pour soulager les autres ascenseurs
principaux. |
|
Ascenseur
pour le 2e étage
|
|
Pour atteindre le troisième étage, 160 mètres plus haut que le deuxième, Monsieur Edoux a
conçu une cabine qui portait 110 passagers pour un poids maximum de 8 tonnes. |
|
Ascenseur pour le sommet
|
|
La cabine supérieure était poussée par un piston hydraulique de 81 mètres de course tandis que la
cabine inférieure formait le contrepoids. Il fallait donc changer de cabine à mi-parcours, suivant une passerelle qui laissait
admirer une impressionnante vue sur le parterre.
Le problème majeur de cet ascenseur provenait des réservoirs d'eau
qui assuraient la force hydraulique nécessaire. En effet il fallait surveiller les niveaux d’antigel; cet ascenseur
ne pouvant fonctionner du novembre à mars. Usé après 93 ans de service, il fut remplacé en 1982 par deux cabines électriques. |
|
Le projet d'une tour de 300 mètres est né à l'occasion de la préparation de l'Exposition
universelle de 1889 . |
|
Les deux principaux ingénieurs de l'entreprise Eiffel, Émile Nouguier et Maurice Koechlin, ont l'idée
en juin 1884 d'une tour très haute, conçue comme un grand pylône formé de quatre poutres en treillis écartées à la base et
se rejoignant au sommet, liées entre elles par des poutres métalliques disposées à intervalles réguliers. C'est une extrapolation
hardie à la hauteur de 300 mètres -soit l'équivalent du chiffre symbolique de 1000 pieds- du principe des piles de ponts que
l'entreprise maîtrise alors parfaitement. Eiffel prend le 18 septembre 1884 un brevet "pour une disposition nouvelle permettant
de construire des piles et des pylônes métalliques d'une hauteur pouvant dépasser 300 mètres". |
|
Le plan de Koechlin
|
|
Pour rendre le projet plus acceptable par l'opinion publique, Nouguier et Koechlin demandent
à l'architecte Stephen Sauvestre de mettre en forme le projet |
|
La Tour Eiffel en 1889
|
|
Sauvestre habille les pieds de socles en maçonnerie, relie les quatre montants et le premier étage
par des arcs monumentaux, place de grandes salles vitrées aux étages, dessine un sommet en forme de bulbe, agrémente l'ensemble
de divers ornements. Le projet sera finalement simplifié, mais certains éléments comme les grandes arches de la base seront
maintenus, contribuant à lui donner son aspect si caractéristique.
La courbure des montants est mathématiquement déterminée pour offrir la meilleure résistance possible
à l'effet du vent. Comme l'explique Eiffel : "Tout l'effort tranchant dû au vent passe ainsi dans l'intérieur des montants
d'arête. Les tangentes aux montants menées en des points situés à la même hauteur viennent toujours se rencontrer au point
de passage de la résultante des actions que le vent exerce sur la partie de la pile au-dessus des deux points considérés.
Les montants avant de se réunir à ce sommet si élevé, semblent jaillir du sol, et s'être en quelque sorte moulés sous l'action
du vent". |
|
Au travers des renouvellements constants des sources d'illumination artificielle, la Tour a toujours
profité des dernières innovations en matière d'éclairage.
Du gaz à l'électricité, des lampes à incandescence à celles
au néon en passant par celles au sodium à haute pression.
Ainsi, à l'aube du XXe siècle, la Tour Eiffel
est-elle passée du gaz à la nouvelle technologie électrique. |
|
Exposition universelle de 1889
|
|
Le développement de l'éclairage électrique a permis de mettre en lumière la Tour de façon
variée au fil des ans. |
|
Publicité Citroën 1925-1936
|
|
Après les éclairages mis en place pour les Expositions universelles de 1900, la publicité imaginée
en 1925 par André Citroën inaugure la mise en lumière colorée de la Tour.
En 1937, André Granet habille sa dentelle
de rampes lumineuses colorées pour l'exposition internationale des Arts et techniques.
L'éclairage mis en place en
1985 comprend 352 projecteurs au sodium de couleur jaune orangé placés à l'intérieur des structures, ce qui les fait ressortir
d'une façon particulièrement éclatante. |
|
A l'expiration de la concession accordée à la Société de la Tour Eiffel, la ville de Paris
a repris en 1980 plus directement la gestion de la Tour par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte la SNTE (Société
Nouvelle d'Exploitation de la Tour Eiffel). |
|
L'une de ses premières actions a été de lancer un ambitieux programme de restauration et rénovation
de la Tour. La structure a été entièrement auscultée, renforcée par endroits, allégée de 1340 tonnes rajoutées au fil des
ans. Les normes de sécurités ont été redéfinies et adaptées aux exigences contemporaines, notamment en matière de sécurité
incendie. L'ascenseur du 3ème étage a été remplacé, ainsi que le vieil escalier en colimaçon qui a laissé place
à un escalier à volées droites. Cette cure de jouvence constamment complétée, contribue à donner à la Tour une très longue
espérance de vie. |
|
|
|
|
|
Un nouvel ascenseur a été installé en 1983 entre le deuxième et le troisième étage de la Tour.
Il comprend quatre cabines, effectuant directement le trajet entre les deux niveaux. Un nouvel escalier
a également été installé à cette occasion, moins dangereux que l'ancien escalier en colimaçon, et qui peut le |
|